"C’est normal qu’on soit mal à l’aise"
Entretien avec Emilia Roig, autrice de L'Envers du Monde (2025)
“Naaaaan… Tu as pris un café avec elle ???? OMG LA CHANCE”
Voilà le genre de réactions que suscite la mention de mon amitié avec Emilia Roig auprès de mes ami·es allemand·es : un mélange d’incrédulité et d’envie, arrosé d’une énorme dose d’admiration.
Ca ne m’a jamais surprise. Emilia étant une femme extrêmement intelligente et charismatique, je comprenais tout à fait en quoi elle pouvait marquer les esprits.
Mais c’était – jusqu’à récemment – assez frustrant.
Car, mon niveau d’allemand étant à la hauteur de l’intégrité d’Emmanuel Macron, c’est-à-dire au sol, je ne peux pas lire ses livres publiés en allemand, qui sont tous des best-sellers ici.
Je me rattrapais avec son infolettre écrite en anglais et que je vous recommande chaudement, The Big Shift.
Mais je regrettais quand même de ne pas avoir accès à ses longs formats.
Heureusement, cette triste situation est enfin corrigée :
Emilia Roig – qui est française – est désormais traduite en français.
Son livre, L’envers du monde, est paru en octobre dernier aux éditions Hors d’Atteinte.
A rebours de beaucoup d’essais féministes qui se concentrent sur des sujets de plus en plus précis, ce livre se donne pour projet de nous montrer comment les structures de domination sont intégrées à tous les domaines de notre vie, et de nous donner le langage nécessaire pour les nommer et les analyser.
C’est un livre à la fois clair, combatif et précis.
Un mélange de rage et de rigueur qui est exactement ce dont on a besoin en ce moment.
Ne passez pas à côté !
Pour vous inviter à découvrir son travail, j’ai posé quelques questions à Emilia Roig sur son écriture, sa vision et ses engagements.
Dans cet entretien, on parle :
de la tension entre certaines formes de militantisme et les milieux spirituels,
de la dangereuse essentialisation de nos identités,
mais aussi de la méthode de travail d’Emilia pour écrire ses livres,
ainsi que de ses conseils d’écriture préférés.
Et à la fin, on découvre que je DÉTESTE un de ses livres favoris (mais on reste amies quand même).
Bonne lecture !
On commence avec une question un peu cliché mais que j’adore : depuis quand écris-tu ?
J’écris depuis que je suis en primaire. J’aimais vraiment beaucoup ça. Quand la maîtresse donnait une rédaction, je prenais le truc très à cœur, je me donnais à fond. Ensuite, j’ai commencé à écrire des journaux intimes, vers 8–9 ans, et je n’ai jamais arrêté. Ce n’était pas forcément avec l’intention d’écrire “bien”, ce n’était pas fait pour être beau, mais en même temps, parfois, je testais des façons d’écrire, je jouais un peu avec la forme.
Dans ma vie professionnelle aussi, j’ai toujours beaucoup écrit — même si c’est moins fun. Des rapports, des documents d’analyse… Mais malgré tout, il y avait une écriture, un ton, une histoire qu’on raconte. J’essayais de les rendre intéressants. Et il y a eu ma thèse, puis mon premier livre.
Écrire un livre, pour toi, c’était une évidence ?
Pas du tout. En fait, c’est quelqu’un qui me l’a proposé, et j’ai dit non. Cette personne a insisté, on a pris un café, on a discuté, et là je me suis dit : OK, j’y vais.
C’est un peu comme pour ma thèse, d’ailleurs. Ce n’était pas prévu non plus. En Allemagne, les thèses sont très valorisées, et je savais que je pouvais en bénéficier. Donc j’ai fait ce choix, mais c’était stratégique, pas un rêve d’écriture à la base.
C’est intéressant que tu parles de cette dimension “stratégique” de ton travail. J’ai remarqué que ton livre démonte point par point les dynamiques d’oppression, avec une volonté nette de ne pas en isoler une seule, mais de montrer leurs interconnexions.
C’est un choix qui va à rebours de la tendance des essais féministes ou engagés en ce moment, qui prennent des sujets de plus en plus précis.
Pourquoi ce choix ? Quelle était la stratégie derrière ?
Ce que je voulais, c’était montrer la face cachée du monde. Mettre en lumière ce qu’on nous dissimule, ce qu’on nous cache pour qu’on continue à accepter le statu quo. On nous présente certaines choses comme si elles allaient de soi, comme si elles étaient objectives ou naturelles. Moi, je voulais retourner le regard, révéler l’envers de cette prétendue réalité.
Mon espoir, c’est qu’en lisant, les personnes se disent : “Ah oui, je l’ai ressenti, je l’ai vécu, mais je n’avais jamais réussi à le formuler.” Que ce soit une expérience un peu libératrice, qu’une intuition puisse se transformer en prise de conscience.
Est-ce que tu voulais donner des outils ?
Je dirais plutôt : valider un ressenti collectif.
On sent que quelque chose ne va pas, que le système est néfaste, et on apprend à normaliser cette violence-là. Je voulais montrer que c’est normal qu’on soit mal à l’aise, qu’on perçoive la violence, parce qu’elle est bien réelle.
Et en Allemagne, comment le livre a-t-il été reçu ?
Il a été tout de suite sur la liste des bestsellers du Spiegel, médiatisé, très discuté dans l’espace public allemand. Le livre est encore lu, je reçois encore des messages de personnes qui me disent que ça les a accompagnées. J’ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que le livre est devenu.
Sans m’attendre à la même ampleur, je suis curieuse de voir comment ça va être en France.
Tu tiens une infolettre que j’adore, qui s’appelle The Big Shift. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce “grand changement” que tu vois venir ?
Je vois une division très nette entre deux types de personnes. D’un côté, celles qui sont anxieuses et qui veulent maintenir le vieux, l’ancien. Celles qui essaient par tous les moyens de préserver l’état actuel des hiérarchies sociales et tout ce qui en découle.
Et de l’autre côté, des personnes qui s’en détachent, comme dans certaines communautés spirituelles ou new age : on respecte la nature, on se nourrit bien, on fait beaucoup de healing work. Mais c’est souvent quelque chose de très individualiste, néolibéral, avec peu d’attache au collectif. La notion de justice devient simplement karmique. Le monde est tel qu’il est, et moi, dans ma petite vie, j’ai passé toutes les étapes de karmic growth, donc je vais bien, tant pis pour les autres.
Et puis au milieu, il y a des personnes militantes qui perdent pied. Se battre contre le système n’est plus efficace. On le voit chez les féministes et les antiracistes : l’opposition au système nourrit le système. Alors que faire ? Rejoindre les rangs des communautés métaphysiques, spirituelles ?
Je le vois surtout chez des personnes que je suis aux États-Unis. En France, on a beaucoup de mal avec le spirituel. En Allemagne, c’est un peu pareil, les gens spirituels sont souvent aux marges de la société, et parfois très problématiques : beaucoup de mouvements de ce type sont aussi racistes, limite nazis.
Et toi, tu te situes où dans tout ça ?
Je suis rêveuse. Mes pensées, au quotidien, sont très tournées vers le monde spirituel.
Mais si je me retrouve face à une injustice, je peux pas juste l’ignorer ou me réfugier dans ma respiration. Comme je n’hésite pas à prendre la parole, de l’extérieur, on a souvent une image de moi comme une personne très militante. C’est le cas, mais avec des réserves.
Je fais partie de groupes, mais je suis solitaire dans ma manière de faire les choses. Je n’ai pas encore trouvé d’espace collectif où je me sente vraiment bien.
Je pense qu’il y a pas mal de choses qu’on fait dans les milieux activistes qui, en réalité, renforcent le système.
Qu’est-ce que tu entends par là, exactement ?
Il y a, dans certains cercles militants, une tendance psychologisante. L’idée qu’il faut guérir, ne pas être confronté à des triggers, éviter à tout prix l’inconfort… C’est une posture individualiste, qui finit par psychologiser les oppressions. Et ça, c’est problématique, parce qu’on perd de vue les racines historiques et systémiques de ces oppressions. L’objectif devient de ne pas être bousculé, plutôt que de s’attaquer aux causes structurelles.
Il y a aussi un phénomène autour des catégories sociales — person of color, queer, non-binary… — qui, dans certains milieux, peuvent se transformer en capital symbolique. Ce sont des catégories qui, dans la société en général, sont stigmatisées, mais qui, dans certains espaces militants, deviennent des sortes de badges donnant accès à une reconnaissance. On oublie alors que l’objectif initial était de dépasser ces catégories, pas de les figer ou de les monnayer. C’est une forme d’instrumentalisation néolibérale.
Et parfois, on tombe dans l’essentialisation. Par exemple lorsqu’on affirme que seule une femme noire pourrait traduire un texte écrit par une femme noire. Est-ce vraiment le cas ? Le débat devient alors immédiatement binaire. Lors de la polémique autour de la traduction de la poétesse noire Amanda Gorman par une personne blanche, lorsque j’ai été interrogée sur cette question, dire qu’une personne blanche pouvait traduire une personne noire suffisait à me faire percevoir comme alignée avec des positions réactionnaires. Or, pour moi, la traduction doit avant tout servir le texte. Cela ne signifie pas ignorer les rapports de pouvoir : dans un contexte où les femmes noires sont structurellement exclues du champ littéraire, la question de qui traduit est aussi politique. Mais ce n’est pas la même chose que de raconter une expérience vécue du racisme ; là, bien sûr, il est essentiel que la parole vienne des personnes concernées.
En définitive, quand on s’identifie trop à une position d’opposition au système, on peut finir par en devenir un rouage. Parce que le système a besoin de cette opposition pour exister, pour entretenir l’illusion du débat démocratique. Il s’en nourrit.
Un exemple très parlant, à mes yeux, c’est le traitement médiatique de la transidentité en France. Quand une personne trans est invitée à la télévision, ce n’est souvent pas pour lui donner la parole, mais pour justifier le maintien d’un débat qui est conduit à partir de questions et de présupposés fondamentalement transphobes. Elle devient alors un outil du dispositif.
J’ai envie de préciser que cette distance aux milieux militants ne signifie pas pour autant que tu restes silencieuse face à l’injustice.
Tu as notamment pris la parole publiquement sur le génocide palestinien, alors même que dans le contexte allemand c’est très difficile et très coûteux de le faire.
On ne peut pas faire autrement !
Quand le système, c’est le silence, parler devient une forme de résistance. Ce n’est pas simplement une opposition, c’est une résistance.
Mon père est juif. Et quand je vois un État génocidaire et colonial s’approprier nos identités, notre histoire, je ne peux pas laisser passer ça. Même si je n’étais pas juive, j’en parlerais mais là, ça me touche encore plus profondément.
Surtout en Allemagne, où la posture est d’une hypocrisie totale, à la fois antisémite et raciste. Des Allemands blancs, dont les grands-parents ont commis un génocide, se convertissent au judaïsme, et maintenant ils me disent que je ne suis pas juive parce que mon père est juif — et que tous les Palestiniens sont des terroristes du Hamas.
Le génocide à Gaza a été un moment de dévoilement. J’ai vécu 19 ans en Allemagne et malgré tout, je n’aurais pas pu imaginer à quel point la discussion serait étouffée, les voix dissidentes silenciées. Même de grandes figures de l’antiracisme allemand sont restées totalement silencieuses sur la question.
Et comment imagines-tu la suite ?
Je veux dire par là, à un niveau global, qu’est-ce que tu espères ?
Selon toi, vers quoi on pourrait aller ?
Je suis antisystème, donc j’en viens à ça : il faut tout cramer. En même temps, je vois bien que ce n’est pas viable. Et je me demande : est-ce mon cynisme qui parle ?
Mais ce qui est clair, c’est que je n’ai pas envie de réformer ce système. Pour moi, le changement dont on a besoin, ce n’est pas simplement d’être plus bienveillant avec ses collègues ou de consommer des produits faits main.
C’est bien plus profond. Une manière d’être dans le monde. Il faut qu’on réapprenne à être autrement, pas juste à faire. Et ça, on n’en parle pas. On apprend à faire, on n’apprend pas à être.
C’est pour ça qu’aujourd’hui, ce que j’écris est plus tourné vers quelque chose de métaphysique, de spirituel. C’est plus lié à la manière dont on interagit avec le monde — la planète, les autres espèces — et à la position qu’on occupe, individuellement et collectivement.
Ça touche encore au politique, bien sûr. Mais ce n’est plus dans les canons classiques, du type : on déconstruit un système, on critique, on analyse à travers des catégories sociales très identifiées comme la classe ou la race.
Sans adopter une perspective universalisante, je parle plutôt de l’être humain dans le cosmos.
Tu as maintenant écrit plusieurs livres.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus d’écriture ? Concrètement, comment fais-tu ? Un peu tous les jours, par exemple ?
Pour ce livre-là — pour les livres politiques avec un message très clair — je commence par tout mettre en vrac dans un document. Vraiment tout : une idée, un mot, des liens vers des articles, un meme.
Ensuite, à un moment donné, j’essaie d’établir une structure dans ma tête. Merci les disserts de terminale ! J’essaie de résumer les idées principales, de penser en séquences. Pour ce livre-là, c’était assez clair : je voulais rendre l’oppression palpable, donc j’ai choisi des thèmes très concrets, liés à la vie de tous les jours.
Une fois que j’ai toutes ces parties, je prends mon vrac et je le place dans cette structure. Et à l’intérieur, je crée des sous-parties. Au début, c’est un gros vrac avec des paragraphes pas finis, parfois même dans plusieurs langues.
Et puis, à un moment donné, commence vraiment l’écriture : j’écris du début à la fin. Les idées qui viennent, je les relie, je les “ficelle” entre elles. C’est comme un puzzle — j’adore les puzzles — et c’est exactement comme ça que j’écris. Parfois je déplace des passages, plein d’idées me viennent tout le temps, je m’envoie des messages vocaux, j’ai l’application Notes toujours ouverte pour ajouter des idées.
J’aime beaucoup les citations aussi, donc je travaille avec. Il y a des livres qui m’accompagnent tout au long du processus, et d’autres citations plus spécifiques selon les thèmes.
C’est compulsif, ça me prend aux tripes — il faut que j’écrive tout le temps. J’ai adoré écrire ce livre, et aussi Das Ende der Ehe.
Le prochain livre que je vais écrire, c’est de nouveau un sujet qui me “consume” : ce sera un livre sur l’inceste, moitié mémoire, moitié essai politique et psychologique, sur le processus de guérison. Il sortira début 2027.
Financièrement, matériellement, comment ça se passe pour toi, l’écriture ?
Une grande partie de mes revenus vient de l’écriture, et aussi de tout ce qui est annexe.
Quand j’écris, je reçois une avance. En Allemagne, ça représente au total plusieurs dizaines de milliers d’euros. C’est divisé en trois : une partie quand je signe, une autre quand je rends le manuscrit, et la dernière quand le livre sort.
Les présentations de livre, en Allemagne, ce n’est pas dans des librairies, mais dans des théâtres. La première, tu n’es pas payée, mais après oui.
Par contre, c’est précaire, tu ne sais jamais si ça va durer. Mes prises de position pour la Palestine ont conduit à un désert financier : mes revenus ont été réduits de moitié. Et il faut toujours négocier, même avec des gens avec qui on a l’habitude de travailler.
Mes livres me rapportent aussi de la visibilité, ce qui me permet de faire des conférences. Je fais pas mal de keynotes, j’ai animé des workshops.
J’ai énormément de chance, et je peux en vivre. J’ai aussi commencé un Substack — ce n’est pas une grande source de revenus, mais je suis très contente d’avoir cette autre source.
Je n’aurais jamais cru ça. J’en suis très reconnaissante.
Si tu pouvais dire quelque chose à quelqu’un qui veut écrire, tu aurais un ou deux conseils à transmettre ?
Lance-toi ! Il faut y aller ! J’avais un petit post-it sur mon bureau, où il y avait écrit : draft now.
Draft, ça veut dire brouillon : un texte, ça se travaille, il ne sort jamais parfait. Il faut commencer, c’est comme tout ce qu’on fait dans la vie.
L’écriture, c’est une photo de ton mental à un moment donné, et il faut que ça sorte à ce moment-là. Faut pas se dire “non mais là, j’en sais pas assez”. C’est comme quand tu prends une photo : tu ne vas pas te dire “non mais je vais vieillir, pas la peine de prendre une photo aujourd’hui !”.
Quelque chose d’autre qui est très important, c’est que les imperfections qu’on voit chez nous, les autres ne les voient pas forcément. Et à l’inverse, les autres peuvent voir d’autres choses dans notre texte, dont on n’a pas conscience. Et puis l’imperfection, c’est aussi ce qui fait la beauté d’un texte.
Bref, il faut y aller !
On s’approche du terme de notre entretien. Y a-t-il une œuvre que tu aimerais faire circuler ?
Le livre qui me vient, c’est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés.
Nooooon ! T’es sérieuse ?
Mais oui !
Ah, explique-moi ! Je l’ai détesté, je l’ai lâché au bout de 20 pages !
Il y a un truc magique dans ce livre. Il m’a bouleversée. Je l’ai acheté en dix exemplaires et je l’ai donné à toutes les femmes importantes de ma vie – et aucune n’a connecté avec. Aucune ne l’a lu jusqu’au bout ! (rires)
Ce livre, soit tu es bouleversée au plus profond de toi-même, soit tu passes à côté.
Je continue de le recommander, parce qu’il y en a que ça va toucher. Tu ne peux pas expliquer le livre, soit tu connectes, soit tu ne te connectes pas.
Il y a un truc mystique.
Je regrette de ne pas pouvoir le relire une première fois.
Tu me donnes envie de le retenter.
On arrive à la dernière question de l’entretien : cette infolettre s’appelle “le grain”, ça t’évoque quoi ?
Je vois le grain d’une photo, le vintage des années 80, la vie des années 80 avec les téléphones à fil, ma mère avec son gilet que j’adorais – un gilet de maison un peu moche – et je lui faisais des câlins. C’est doux, c’est un truc intime, maison, chaleureux.
Oh, trop bien ! Merci beaucoup, Emilia !
Pour entamer votre propre dialogue avec Emilia Roig, c’est par ici :



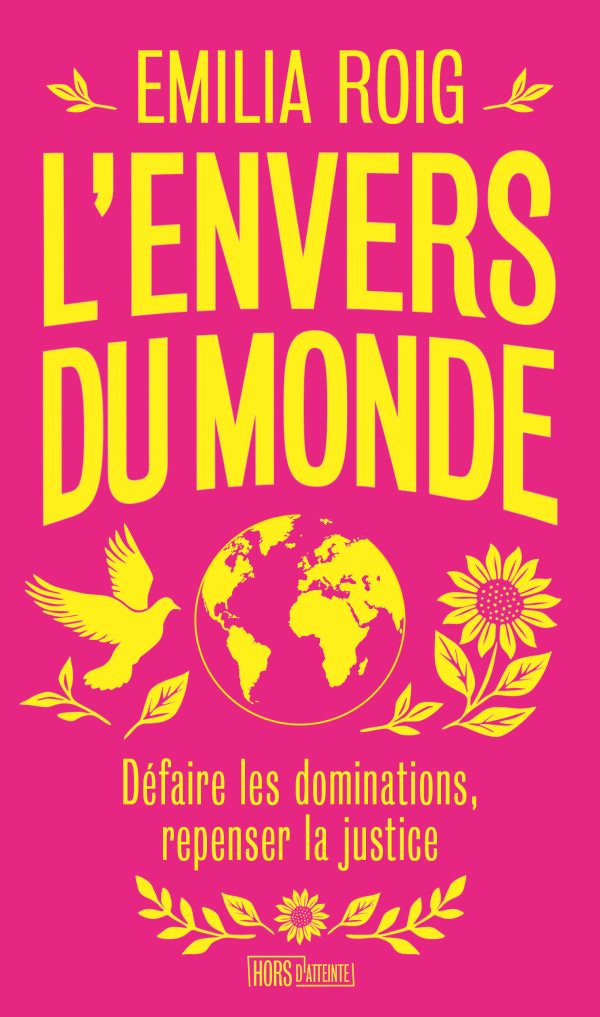

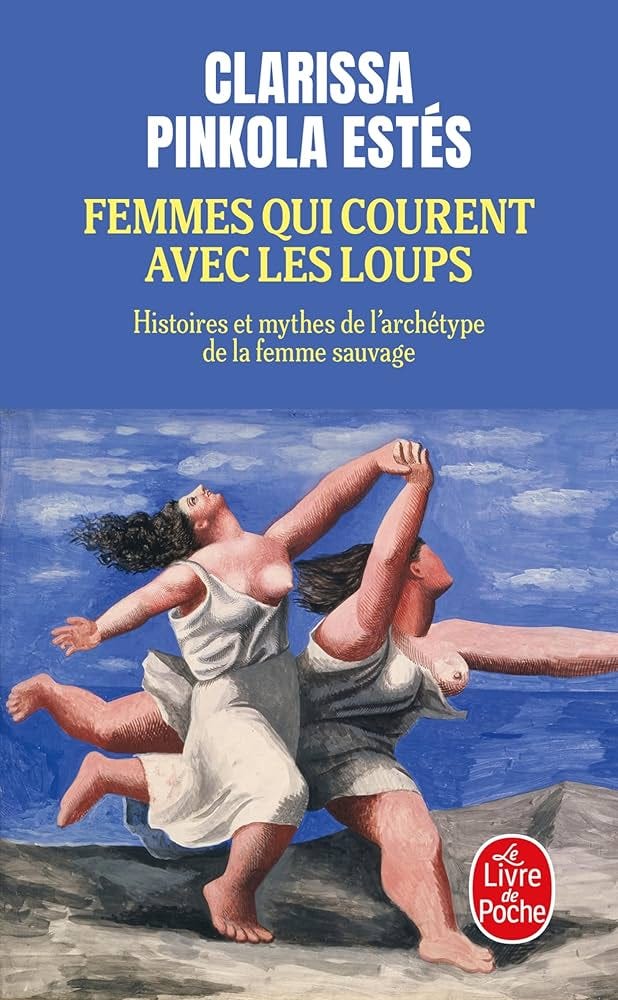
Je découvre l'autrice et ce livre, je m'en vais voir ça de plus près... Et d'autant plus que je fais partie de celles qui ont aimé Femmes qui courent avec les loups ! 😉 (qui est un peu long, je le concède, mais qui a été pour moi assez libérateur, et j'y reviens parfois !)
Merci pour cette belle conversation et ton soutien ma chère Louise ❤️