"L’écriture, ça donne du pouvoir"
Entretien avec Lauren Delphe, autrice de Faite de cyprine et de punaises (éd. Ixe, 2022)
Il y a des livres comme ça que tu regardes du coin de l’œil un petit moment avant de t’y lancer.
Comme avec un crush : vous vous observez l’un·e l’autre, pas vraiment timides mais pas totalement à l’aise non plus, vous vous jaugez quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant d’oser vous parler.
C’était le cas pour Faite de cyprine et de punaises, par Lauren Delphe (éd. Ixe, 2022).
J’ai été intriguée tout de suite et pourtant la rencontre s’est fait un peu attendre. Je ne sais pas si c’est le titre, dont les deux éléments principaux court-circuitent la pensée logique, moi qui suis plutôt du genre control freak, ou bien juste un concours de circonstance – mais quand, enfin, je l’ai ouvert : je ne l’ai plus lâché.
Je l’ai dévoré avec tellement d’enthousiasme que B piaffait d’impatience, attendant que je le termine pour pouvoir le commencer.
Ça n’a pas manqué : iel l’a aussi lu en quelques jours, et je voyais défiler sur son visage toutes les nuances de joie, de tristesse, de colère (et de plein d’autres émotions plus compliquées à nommer) par lesquelles ce livre vous fait passer.
Faite de cyprine et de punaises est un roman magnifique. En particulier si vous êtes lesbienne ou que vous avez été lesbienne ou que quelque chose vous dit que vous pourriez bien le devenir. Il est touchant, extrêmement drôle, intelligent et aussi, comme Lauren le dit bien, vulnérable.
Attention, rien à voir avec la douce fragilité fantasmée des femmes en régime hétéropatriarcal : c’est plutôt le roman d’une vulnérabilité gouine où se nichent des kilotonnes de radicalité… et de fun.
C’est aussi l’un des très rares livres qui parle de validisme à partir de l’expérience vécue d’une personne concernée.
Je ne veux pas vous en dire plus parce que je sais que vous aussi, vous allez avoir un crush, et que je préfère vous laisser la surprise de découvrir ses contours.
Ne faites pas comme moi : n’attendez pas des plombes avant de vous lancer.
Comme j’étais complètement emballée par son livre, j’ai contacté Lauren pour lui demander un entretien et j’ai eu la chance qu’elle passe à Berlin cet été.
On s’est rencontrées dans un café pas loin de Kotti (où je suis évidemment arrivée essoufflée et en retard), on a parlé de son parcours avec l’écriture bien sûr, de publication, de l’articulation entre vérité et fiction et du syndrome de l’impostrice.
Notre discussion m’a fait un bien fou.

En la relisant pour la mettre en forme, j’ai eu de nouveau la sensation de respirer à plein poumons, expérience rare dans une atmosphère politique qui se vicie un peu plus chaque jour.
On fait donc une petite pause dans la série sur l’anticapitalisme pour prendre un grand bol d’air frais (et gouin).
Je suis heureuse et fière que vous ayez à votre tour la chance d’entendre la voix directe, radicale et joyeuse de Lauren.
Bonne lecture.
Depuis quand tu écris et pourquoi ?
Je suis passée par un long temps de réflexion sur l’écriture. J’ai mis beaucoup de temps avant de me lancer.
En fait, j’ai dû partir de France et aller à Montréal avant d’oser. J’avais 19 ans. A Montréal, les gens se permettaient plus de trucs, étaient libres d’explorer leur créativité… Moi je crevais de jalousie dans mon petit truc français, cette attitude qui te fait croire que l’écriture c’est sacré, que tu ne peux que lire de façon très passive.
La jalousie m’a démangée jusqu’au point où je me suis mise à le faire.
Il y a pas mal de revues étudiantes de littérature et d’écriture à Montréal et elles proposent régulièrement des appels à textes, « on cherche 1000 mots sur tel sujet ». Je me suis lancée comme ça, 1000 mots à la fois. Ma toute première publication dans une revue a eu lieu en 2016, j’avais 21 ans.
J’ai remarqué que j’aimais bien écrire et que ça marchait bien. Les éditrices des revues étaient adorables et mettaient des petits cœurs dans la marge de certains passages.
Ces retours très positifs m’ont encouragée, alors j’ai continué et, petit à petit, j’ai écrit un manuscrit entier.
Ce manuscrit entier, justement, comment il est venu à voir le jour ?
J’avais une histoire en moi et j’ai voulu l’écrire.
Au début, l’écriture, c’était un jeu. Ensuite, j’ai eu envie de raconter quelque chose. C’était fun de faire 1000 mots mais c’était aussi une façon de se limiter.
Une fois que j’ai réalisé qu’écrire, c’était atteignable, que c’était possible, j’avais une histoire en moi et j’avais aussi le rêve d’un roman, parce que c’est un format que je lis. Je pense que je me suis dit, je vais écrire un roman comme je lis un roman.
J’ai commencé et fini le roman en 2020 – en partie pendant le confinement.
Comment tu t’es organisée, concrètement, pour l’écriture du roman ?
J’avais le concept en tête.
Je vois beaucoup de séries télé dans lesquelles on donne l’opportunité aux personnages, dans leur vingtaine, de faire n’importe quoi, d’avoir une vie romantique merdique, de faire du mieux qu’ils peuvent et d’échouer. Je trouvais qu’on n’avait pas ce genre de récit du côté des lesbiennes, qu’on avait complètement laissé de côté la représentation de notre sexualité – pour des raisons historiques très compréhensibles, mais il me semblait qu’on pouvait faire ça. On a notre pop culture lesbienne contemporaine à travers les réseaux sociaux, qui est très riche et très drôle, mais on ne la trouve pas encore beaucoup dans la littérature.
Je me suis dit, maintenant qu’on a eu des lesbiennes politiques et féroces pour nous créer un espace, on peut l’explorer et se l’approprier. Je voulais traduire une histoire hétéro en histoire lesbienne, avec cette même légèreté.
Bon, ça a à moitié marché parce que j’ai redécouvert que les lesbiennes ont souvent une histoire lourde. En écrivant le roman, je me suis rappelé que la lesbophobie existait et c’est devenu plus sombre presque malgré moi.
Mais je voulais montrer nos dramas, nos exes de partout. C’est ma vie !
As-tu écrit tous les jours ?
Oui, mais je n’ai pas une heure précise. J’écris beaucoup sur mon téléphone, j’écris constamment. Dès que j’ai 5 minutes, j’écris, dans mes notes, mes brouillons WhatsApp, mes brouillons de mail et je regroupe quand j’y pense. J’écris pas dans un café assise quelque part… sauf quand il est temps de me corriger et que j’ai la flemme de me relire.
D’ailleurs, je ne retiens pas tout ce que j’écris.
Petite incise par rapport à notre entretien mais en t’écoutant, je me demande si tu qualifierais une partie de ce que tu écris de journal intime ?
Non. J’avais pas de journal intime et je n’en ai toujours pas. Je n’essayais pas de faire de l’écriture thérapeutique.
Je voulais faire de la fiction et finalement je me retrouve partout. J’ai l’impression que je me retrouve plus dans la fiction que dans le journal intime. Il me semble que j’y écris plus librement, que je me projette dans mes lectures comme je me projette dans l’écriture. En revanche, j’ai pas l’impression d’avoir découvert beaucoup de choses sur moi, j’étais déjà très au courant de mes problèmes.
Pour la fiction, je cherche un arc narratif qu’il n’y a pas forcément dans la vie, j’essaie de terminer sur une leçon, ou de chercher l’optimisme. Les retours ont été qu’à la fin ça se termine mal, donc apparemment j’ai cherché l’optimisme mais je ne l’ai pas trouvé. (rires)
Dans ma vie de tous les jours, je ne cherche pas forcément à comprendre le sens de la vie alors que dans un roman, il en faut un.
Justement, j’aimerais qu’on parle un peu plus de cette frontière entre fiction et réalité. Ce n’est pas un journal intime et en même temps, tu le disais à l’instant, c’est de ta vie dont tu parles.
Comment tu vois cette articulation ?
Ce qui est intéressant, c’est que les gens ont clairement projeté que je parlais de moi, mais ils ont projeté des trucs très différents ! Je l’ai bien perçu lors des rencontres en librairie autour du livre. Il y en a qui ont posé des questions sur la vulnérabilité, les violences, et il y en a d’autres qui n’ont vu que la sexualité. On me parle différemment selon l’aspect qui est projeté.
J’étais soit la personne la plus triste sur terre, soit la personne la plus sexuelle sur terre, et dans tous les cas, les gens pensaient que c’était moi dans le livre, et pas un personnage. Je n’ai pas écrit le livre que les gens ont lu !
Ce qui devient clair, après en avoir discuté avec Alex Lachkar qui travaille sur Virginie Despentes, c’est que j’ai voulu montrer quelque chose de vulnérable et me démarquer d’une tendance littéraire à présenter des lesbiennes féroces, comme peut le faire Despentes par exemple, dont les personnages lesbiens sont redoutables.
Les lesbiennes ont dû être féroces parce qu’il a fallu qu’on s’impose contre les agressions sexuelles et les agressions tout court qui nous menacent : on a ce passé de hyènes, de personnes fortes et politiques.
A mon sens, c’est ce passé et ce sont ces personnages qui ont ouvert la voie et qui nous permettent aujourd’hui de dire : on a été un peu brisé·es par la lesbophobie, on est un peu déprimé·es.
Quand tu entends Despentes aujourd’hui en interview, elle dit clairement qu’elle est douce, vulnérable mais elle ne se le permet pas dans ses romans. Constance Debré pareil, elle met en scène dans ses autofictions des personnages très forts, très durs, et dans Nom elle dit qu’elle a rejeté sa famille, on sent bien qu’il y a une faille.
J’avoue que j’ai du mal avec Debré, justement parce que ses personnages lesbiens me paraissent des caricatures d’homme cis het avec des seins.
Il y a ce côté « moi les petites meufs je les sodomise » que je trouve vraiment sans intérêt.
Oui, mais si elle est publiée dans une énorme maison d’édition, c’est aussi parce que c’est ça qu’elle donne à voir.
Oui, tu as raison. Mais revenons à toi, ça m’intéresse plus !
Tu parlais de ce que tu as mis de toi dans le livre.
Je me demande aussi comment tu as pensé la réaction de tes proches ? C’est toujours une question que je me pose : comment les gens qui font partie de l’histoire vivent d’être intégrés à une autofiction ? Asking for a friend.
Je n’ai pas cette problématique, je n’ai pas de relations familiales sauf avec mon adelphe, qui ne lit pas les recensions et les retours.
Plus jeune, j’aurais vraiment pensé à la réaction de mon entourage. Là, j’ai pu écrire tout ce que je voulais parce que je savais que j’étais libre.
Au-delà de la famille, tes ami·es, tes ex·es ?
C’est un livre basé sur Montréal et publié en France donc ça aide ! Changer de continent, ça passe crème (rires).

Ah oui, parlons de la publication – par une maison d’édition française, Ixe. Comment vous vous êtes trouvées, la maison d’édition et toi ?
J’ai commencé par envoyer mon manuscrit au Canada, à des maisons d’édition que je lisais.
Les éditions Triptyque, par exemple, qui ont une collection queer. J’ai eu un retour très encourageant sur le manuscrit, mais négatif : ils ne pouvaient pas me publier car je suis française et je n’ai pas la nationalité canadienne.
On m’a conseillé de regarder les éditions féministes en France.
Je connaissais les éditions Ixe grâce à un marché du livre anarchiste, où j’avais trouvé un livre sur les Riot Grrrls (NDLR : Pussy Riot Grrrls. Emeutières, Manon Labry, 18€) et les éditions Blast. J’ai envoyé mon manuscrit aux deux. Les éditions Ixe m’ont répondu positivement et Blast m’a répondu négativement mais très gentiment, avec un super retour.
J’ai vraiment eu de la chance d’avoir un retour très positif dès le départ.
Quels enjeux y a-t-il autour de la publication pour toi ?
Un enjeu militant.
J’ai écrit le roman en plein confinement, je passais ma vie à écouter mes podcasts. Ton entourage passe de tes potes aux plus grandes militantes du monde : j’étais boostée.
Je pense en particulier aux épisodes de l’émission La Série Documentaire, sur France Culture, « Sortir les lesbiennes du placard ».
Dans le podcast, on voyait comme c’était important de créer des histoires lesbiennes, de les faire circuler. Et je me suis dit que c’était important que moi aussi, j’y participe. Ça m’a encouragée à publier moi aussi. Le dernier livre qui m’a vraiment marquée, c’est Colza de Al Baylac (éd. Blast), et je me suis dit que c’était un livre extraordinaire, un geste communautaire.
En plus, je savais que c’était pas écrit, qu’on n’avait pas vraiment d’histoire de lesbiennes qui faisaient n’importe quoi avec leur vie… alors qu’on fait ça quotidiennement. Je ne voulais pas raconter de coming out, ni de grande histoire d’amour, parce que ce n’est pas ma vie.
C’était important de rajouter mon histoire à notre histoire commune. Dès que j’ai un peu de mal, que je doute, je retourne sur la politique. Je le vois comme un geste militant.
J’étais très intimidée pour envoyer le manuscrit alors que c’est rien, c’est juste un mail ! c’est dommage qu’on ait tellement de mal à le faire.
Il y a une phrase d’Audre Lorde qui m’a beaucoup aidée, où elle dit en substance : « moi, en tant que poète noire et lesbienne, j’ai fait mon travail, est-ce que vous faites le vôtre ? ». Je me dis qu’en effet, je dois faire mon travail.
Je m’aide beaucoup de ce que disent les lesbiennes.
Je suis convaincue que pour créer dans la durée, on a souvent besoin de soutien. Du coup, je me demande : toi, qui te soutient ?
Lors de l’écriture, j’étais entourée de personnes qui écrivaient. Pas physiquement, mais à travers ce que je lisais et ce que j’écoutais. J’avais Alice Coffin dans les oreilles tout le temps, j’étais entourée de ces lesbiennes-là. Je n’avais donc pas vraiment besoin de quelqu’un d’autre pour me sentir soutenue.
En revanche, actuellement, dans mon entourage militant, il y a une écrivaine avec qui je parle souvent.
Son livre porte sur un procès de féminicide (NDLR : Si la rose vient à faner, Pauline de Vergnette, éd. Blast, 2023, 14 €). On militait sur cette cause-là et c’est à travers cette lutte qu’on s’est rencontrées. On parle pas mal d’écriture. Elle a fait des études littéraires et sait très bien ce qu’elle fait. Son style est très particulier : je lui demande comment elle fait, j’essaie de comprendre, et malheureusement il n’y a pas de secret !
Un autre de mes dadas, c’est le côté matériel de la vie d’autrice.
Côté finances, ça se passe comment pour toi ?
Mon job paie mon écriture. Ce qui me permet d’avoir un job, c’est que je me dis que ce que je fais tous les jours, c’est pour payer l’écriture.
Plus je suis prostrée à mon job et plus j’ai envie d’écrire. C’est la jalousie qui m’a fait écrire au départ, qui m’a bouffée, et c’est la même chose quand je passe 10 heures à bosser : à la fin j’ai envie d’être moi et d’écrire. Je pense que la frustration de mon job m’aide à voir où sont mes priorités. Quand je suis très frustrée, je vais forcément écrire par rapport à ça en soirée.
Donc le travail salarié remplit deux fonctions : me nourrir et me motiver.
Le monde où on pourra vivre de notre art… je ne sais pas s’il existe.
J’essaie de trouver de la joie là-dedans, de faire avec. Audre Lorde a écrit un très bel essai où elle explique utiliser sa douleur pour la transformer en action. On se nourrit beaucoup du malheur, ça ouvre une grande intensité d’émotions. Alors certes, l’artiste maudit ça existe, mais elle essaie aussi de faire quelque chose avec sa douleur pour ne pas la revivre, ne pas rester dans cette malédiction perpétuelle, même si c’est dur.
C’est aussi un geste militant. Pour mon prochain livre, je voudrais que ce ne soit pas aussi sombre.
Qu’est-ce que tu dirais à quelqu’un·e qui veut écrire, qui peut-être voudrait publier un livre un jour, et ne sait pas trop dans quelle direction aller ?
Il faut accepter que le syndrome de l’impostrice est légitime.
Si tu écris et que tu es lesbienne, évidemment que tu te sens impostrice parce que la publication n’est pas faite pour toi. Il faut bien comprendre que le système de publication n’a pas été fait pour nous. Il a été fait pour nous exclure. C’est fait pour des mecs cis-het, pour des gens riches, privilégiés, pas pour des lesbiennes précaires.
La littérature mainstream a toujours été cis-het. C’est un système de propagande pour l’hétéropatriarcat. Publier dans ces maisons d’édition populaires et sexistes c’est participer à un système pourri, à des degrés divers. Quand tu vois ce qui sort chaque année, évidemment que t’as pas envie d’en faire partie.
Ça me fait penser à ce qu’explique Alice Coffin sur le mythe de la compétence : elle montre que pendant très longtemps, on a cru que c’était la compétence qui justifiait pourquoi il n’y avait que des mecs au pouvoir. Mais c’est un mythe, c’est le privilège et pas la compétence qui explique la répartition actuelle du pouvoir.
Dans l’édition c’est pareil, ce sont les plus privilégiés qui sont publiés. C’est compliqué de se sentir légitime quand tu envoies ton manuscrit à une industrie qui te discrimine. Heureusement qu’il y a des lesbiennes qui nous ont mâché le travail !
Je veux pas dire « lance-toi » parce que moi ça m’a pris énormément de temps pour le faire. Ce serait un conseil bancal. Je dirais plutôt : n’attends pas d’être publié·e pour écrire.
Il faut se réinventer sur cette question de la légitimité, trouver ailleurs nos sources de légitimité.
Tu dois croire en ton histoire, te faire confiance sur le fait que tu as quelque chose à dire. Si tu as une histoire à écrire, il faut l’écrire. Pour réussir à l’écrire, il faut te donner tout le soutien nécessaire pour que tu te rappelles que ton histoire est importante.
Dans le syndrome de l’impostrice il y a aussi une peur d’explorer son potentiel, de faire surgir ce qu’il y a en nous. Mais l’écriture, c’est empuissançant, ça donne du pouvoir, ça donne un projet qui est à toi et à toi seul·e. Il ne faut pas avoir peur de son potentiel.
Les gens ont peur d’échouer parce qu’on nous a dit qu’on était nul·les, qu’on n’allait rien faire dans notre vie. L’écriture permet de déconstruire ces pensées là, tout ce que t’a dit ton entourage, la société, ta famille.
C’est à travers l’écriture, c’est en écrivant qu’on réalise qu’on est important, qu’on a quelque chose à dire.
Wow. Difficile de rebondir là-dessus. C’est le meilleur conseil que j’aie entendu je crois.
On finit avec ma question dite Lauren Bastide : ma newsletter s’appelle « le grain » – ça t’évoque quoi ?
Bon, j’ai vraiment l’impression d’être mièvre mais ça me fait penser à ce que tu fais – mettre des petites graines dans l’esprit des personnes pour leur dire : vous êtes capable de le faire.
C’est ta propagande lesbienne. Tout doucement, mais sûrement.
Mille mercis, Lauren !
Je suis certaine qu’après avoir lu cet entretien, vous avez encore plus envie de lire le premier roman de Lauren – achetez-le, prêtez-le, offrez-le, vos potes vous remercieront.
Cet entretien s’inscrit dans une série d’interviews avec des auteurices dont j’admire le travail, pour parler de l’écriture, et de ses conditions matérielles de production et de diffusion :
Pauline Gonthier, autrice des Oiselles sauvages (éd. Julliard, 2022) ;
Tal Madesta, auteur de La Fin des monstres (éd. La Déferlante, 2023) ;
Maaï Youssef et Lucille Dupré, autrices de Lettres d'hiver, lettres d’été (éd. Belfond, 2023) ;
Erika Nomeni, autrice de L’Amour de nous-mêmes (éd. Hors d’Atteinte, 2023) ;
Lou Eve, autrice de Sous les Strates (éd. Les Escales, 2023).
Le but, c’est de vous (nous) donner l’envie et les outils pour se lancer dans l’écriture, ou poursuivre sans se décourager.
S’il y a des questions que vous voudriez voir abordées, n’hésitez pas à m’écrire pour me le dire.
P.-S. : puisqu’on parle écriture, je voulais vous dire qu’en parlant avec vous pendant les ateliers d’écriture, et autour du guide de l’écriture introspective, j’ai réalisé que pour beaucoup, ce dont vous aviez besoin c’était vraiment d’amorces d’écriture pour vous aider à vous lancer.
Alors j’ai créé une petite fiche avec 17 exercices d’écriture introspective accessibles et variés. Vous pouvez la télécharger gratuitement ici.


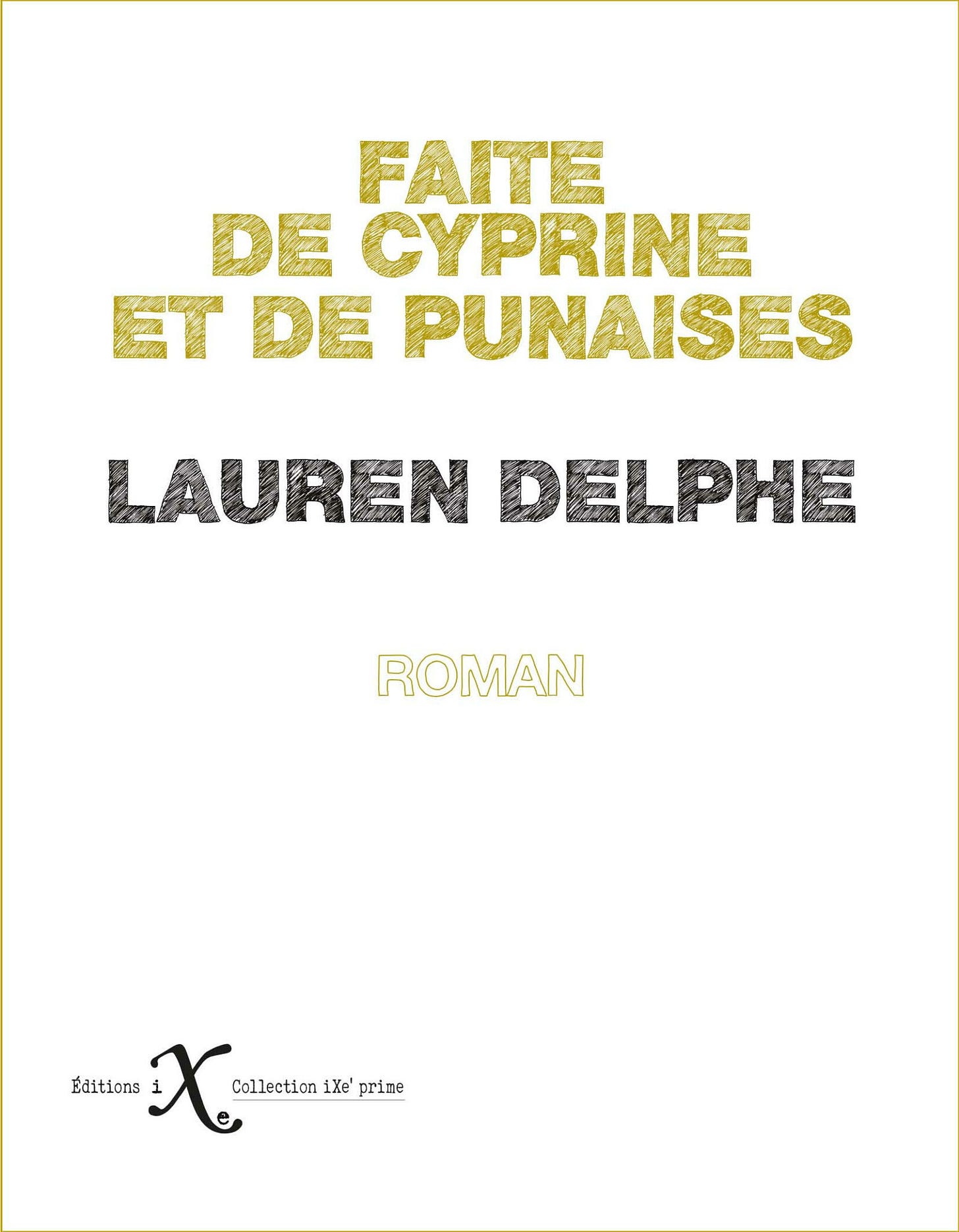
Un super entretien trop réjouissant à lire ! Merci 💚
WOW!!